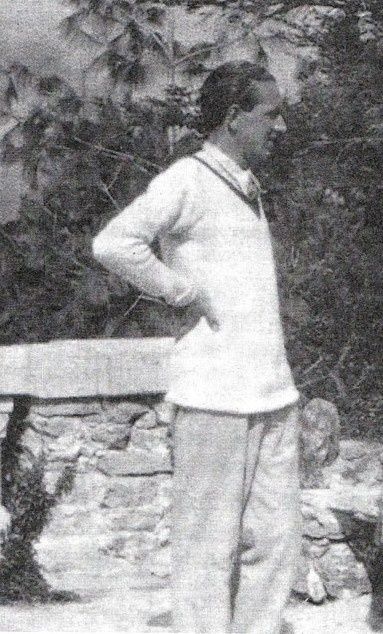
Julius Evola vers 1925.
[Note du blog : Bien que ne partageant pas toutes les positions de l'auteur, nous soumettons à nos lecteurs ce passage qui nous semble présenter un intérêt traditionnel.]
Révolte contre le monde moderne
Première partie
LE MONDE DE LA TRADITION
[...]
20. HOMME ET FEMME
Pour compléter ces considérations sur la vie traditionnelle, on fera brièvement allusion au monde de la sexualité.
Ici aussi, la conception traditionnelle présente des correspondances entre réalités et symboles, actions et rites, des correspondances dont on tira les principes nécessaires à la compréhension des sexes et des relations qui doivent s’établir, dans toute civilisation normale, entre l’homme et la femme.
Dans le symbolisme traditionnel, le principe surnaturel fut conçu comme « mâle », celui de la nature et du devenir comme « femelle ». En termes grecs, masculin est l’« Un » — τό έν — qui « est en soi-même », complet et suffisant ; féminine est la dyade, principe de l’altérité, de l’« autre que soi », donc aussi du désir et du mouvement. En termes hindous (doctrine du Sâmkhya), masculin est l’esprit impassible — purusha —, féminine est prakriti, matrice active de toute forme conditionnée. La tradition extrême-orientale exprima des concepts équivalents dans la dualité cosmique du yang et du yin : le yang — principe masculin — y est associé à la « vertu du ciel », le yin, principe féminin, à la « vertu de la terre »(1).
(1) Pour d’autres références métaphysiques et mythiques, cf. J. Evola, Métaphysique du sexe, cit. Chez les philosophes de la dynastie Sing plus particulièrement, on trouve l’enseignement que le Ciel « produit » les hommes, les femmes étant produites par la Terre, et que pour cette raison la femme doit être soumise à l’homme, comme la terre l’est au ciel (cf. R.H. Plath, Religion der alten Chinesen, cit., I, p. 37).
Considérés en eux-mêmes, les deux principes s’opposent l’un à l’autre. Mais dans l’ordre de cette formation créatrice dont nous avons dit à plusieurs reprises qu’elle est l’âme du monde traditionnel et dont nous verrons plus loin la traduction historique en rapport avec le conflit des races et des cultures, ces principes se transforment en éléments d’une synthèse où chacun des deux termes garde une fonction distincte. Ce n’est pas le lieu de montrer que derrière les représentations mythiques de la « chute », se cache souvent l’idée d’une identification du principe masculin au principe féminin, d’une perdition du premier dans le second, dont il finit par épouser le mode d’être. Quoi qu’il en soit, lorsque cela se produit, lorsque ce qui est, de par sa nature, principe de soi-même, succombe, en s’ouvrant aux forces du « désir », à la loi de ce qui n’a pas en soi son propre principe, c’est bien d’une chute qu’il faut parler. C’est là-dessus, dans l’ordre de la réalité humaine, que se fonde l’attitude de méfiance dont témoignent plusieurs traditions à l’égard de la femme, souvent considérée comme une source de « péché », d’impureté, de mal, comme une tentation et un danger pour celui qui se tourne vers le surnaturel.
Mais on peut opposer à la direction de « chute » une autre possibilité, la relation juste. Celle-ci s’établit lorsque le principe féminin, dont la nature même est référence à autrui, se tourne non vers ce qui de nouveau fuit, mais vers une fermeté « virile ». Alors apparaît une limite. La « stabilité » est transmise, et ce au point de transfigurer intimement chaque potentialité féminine. Ainsi se produit une synthèse positive. Il faut donc une « conversion » du féminin, afin que celui-ci soit tout entier au service du principe opposé ; mais pour ce faire, il importe que le principe masculin reste lui-même absolument, intégralement. Alors — dans l’ordre des symboles métaphysiques — la femelle devient l’« épouse » qui est aussi la « puissance », la force instrumentale génératrice recevant du mâle immobile le principe premier du mouvement et de la forme, conformément à la doctrine déjà mentionnée de la Çakti, doctrine qu’on peut aussi retrouver, diversement exprimée, dans l’aristotélisme et le néoplatonisme. Et l’on a déjà fait allusion aux représentations symboliques du tantrisme tibétain, très significatives à cet égard, où le mâle « porteur-de-sceptre » est immobile, froid, fait de lumière, tandis que la Çakti dont il est l’axe et qui s’enroule autour de lui, a pour substance la flamme mobile (2).
(2) Dans le symbolisme érotique de ces traditions, la même signification revient avec la représentation du couple divin en viparîta-maithuna, terme qui désigne une étreinte où l'élément masculin est immobile, tandis que la Çakti est à l’origine du mouvement.
Ces contenus, déjà indiqués à plusieurs reprises, servent de fondement, sous cette forme spécifique, à la norme traditionnelle relative aux sexes pris dans un sens concret. C’est une norme qui obéit au principe même du régime des castes, et qui renvoie aux deux piliers que sont le dharma et la bhakti ou fides : nature propre et dévouement actif.
Si la naissance n’est pas un hasard, le fait — tout particulièrement — qu’on s’éveille à soi-même dans un corps masculin ou dans un corps féminin ne sera pas non plus le fruit du hasard. Ici aussi, la différence physique doit être conçue comme le pendant d’une différence spirituelle ; il suit de là qu’on n’est physiquement homme ou femme que parce qu’on l’est transcendantalement, et que l’appartenance à tel ou tel sexe, loin d’être chose insignifiante dans l’ordre de l’esprit, est le signe révélateur d’une voie, d’un dharma distinct. On sait que la volonté d’ordre et de « forme » constitue la base de toute civilisation traditionnelle ; que la loi traditionnelle ne pousse pas vers l'in-qualifié, l’égal, l’indéfini — vers ce qui rendrait les différentes parties du tout semblables, sous l’effet de l’homogénéisation ou de l’atomisation —, mais veut que ces parties soient elles-mêmes, expriment de plus en plus parfaitement leur nature propre. Aussi, dans le domaine spécifique des sexes, homme et femme se présentent-ils comme deux types. Celui qui naît homme doit s’accomplir en tant que tel, celle qui naît femme doit se réaliser comme telle, en tout et pour tout, dépassant toute promiscuité et tout mélange. Quant à l’orientation surnaturelle, homme et femme doivent avoir, chacun, leur voie propre, qui ne peut pas être modifiée, sauf à tomber dans un mode d’être contradictoire et inorganique.
Le mode d’être qui correspond éminemment à l’homme, on l’a déjà envisagé ; et il a aussi été question des deux principales formes de rapprochement de la valeur de l'« être soi-même » : Action et Contemplation. Le Guerrier (le Héros) et l'Ascète sont donc les deux types fondamentaux de la virilité pure. Symétriquement, la nature féminine présente elle aussi deux types. La femme se réalise comme telle, s’élève au même niveau que l’homme comme Guerrier et comme Ascète, en tant qu’elle est Amante et en tant qu’elle est Mère. Ce sont là les bipartitions d’une même origine idéale : de même qu’il y a un héroïsme actif, ainsi il existe un héroïsme passif ; il y a l’héroïsme de l’affirmation absolue et il y a l’héroïsme du dévouement absolu. L’un peut être aussi lumineux que l’autre, l’un peut être aussi riche de fruits que l’autre pour ce qui concerne le dépassement et la libération, dès lors qu’il est vécu avec pureté, dans le sens d’une offrande. Cette différenciation dans le complexe héroïque détermine précisément le caractère distinctif des voies d’accomplissement pour l’homme et la femme en tant que types. Au geste du Guerrier et de l’Ascète qui, l’un au moyen de l’action pure, l’autre au moyen du détachement total, s’affirment dans une vie qui est au-delà de la vie — répond chez la femme le don total à un autre être, le fait d’être tout entière pour un autre, qu’il s’agisse de l’homme aimé (type de l’Amante — femme « aphrodisienne ») ou du fils (type de la Mère — femme « démétrienne »). En cela, la femme trouve le sens de sa vie, sa joie propre, sa justification. C’est la bhakti ou fides, qui pour la femme traditionnelle constitue la voie normale et naturelle de participation — dans Tordre de la « forme » et, quand cette voie est vécue absolument, en mode trans-individuel, au-delà de la « forme ». Se réaliser de manière toujours plus nette selon ces deux directions distinctes, qu’on ne saurait confondre, en réduisant tout ce qui, dans la femme, est masculin et tout ce qui, dans l’homme, est féminin, en tendant donc vers la « femme absolue » et vers l'« homme absolu » — telle est la loi traditionnelle gouvernant les sexes, selon les différents plans d’existence.
Du point de vue traditionnel, la femme ne pouvait donc entrer dans Tordre hiérarchique sacral que de façon médiate, à travers la relation avec l’autre — avec l’homme. En Inde les femmes, même de caste supérieure, n’avaient pas d’initiation propre ; elles n’appartenaient à la communauté sacrale des nobles — ârya (*)— que par l’intermédiaire de leur père, avant le mariage, et seulement par la médiation, après le mariage, de leur époux, qui était aussi le chef mystique de la famille (3). Durant toute sa vie, dans la Grèce dorienne, la femme n’avait pas de droit à elle ; pour tout le temps où elle était célibataire, elle avait pour κύριος son père (4). A Rome, conformément à une spiritualité apparentée, la femme, loin d’être I’« égale » de l’homme, était juridiquement assimilée à une fille de son mari — filiae loco — et à une soeur de ses propres fils — sororis loco ; jeune fille, elle dépendait de la potestas de son père, chef et prêtre de sa gens ; une fois épouse, elle était, dans le mariage commun et selon une rude expression, in manum viri. On retrouve aussi ailleurs (5) ces normes traditionnelles de dépendance de la femme : elles ne signifient pas injustice et abus de pouvoir, comme voudraient le croire les « libres esprits » modernes, mais servaient à définir les limites et le lieu naturel de la seule voie spirituelle conforme à la vraie nature féminine.
(*) [Note du blog : Sur le sens traditionnel d'ârya voir : « Aryen : race ou culture ? ».]
(3) Cf. E. Sénart, Les castes dans l’Inde, cit., p. 68 ; Mânavadharmaçâstra, IX, 166 ; V, 148 ; cf. V, 155 : « Il n’y a ni sacrifice, ni pratique pieuse, ni jeûne, qui concernent les femmes en particulier ; qu’une épouse chérisse et respecte son mari, elle sera honorée dans le Ciel ». Ce n’est pas le lieu de traiter du sacerdoce féminin et de dire pourquoi il ne contredit pas l’idée qu’on vient d’exposer. Traditionnellement, ce sacerdoce eut un caractère lunaire ; il ne se rapportait pas à une autre voie, mais exprimait un renforcement du dharma féminin comme effacement absolu de tout principe personnel, afin de faire place, par exemple, à la voix de l’oracle et du dieu. Mais plus loin nous parlerons de l’altération propre à certaines cultures de la décadence, où l’élément lunaire et féminin usurpe le commandement hiérarchique. Il faut envisager à part le rôle sacral et initiatique de la femme dans la « voie du sexe » (sur ce point, cf. J. Evola, Métaphysique du sexe, cit.).
(4) Cf. Handbuch der klassischen Altertumswissenschaft, cit., IV, p. 17.
(5) Ainsi, pour ce qui concerne la Chine ancienne, on lit dans le Niu-kie-tsi-pien (V) : « Lorsqu’une femme passe de la demeure paternelle à celle de son époux, elle perd tout, même son nom. Elle n’a plus rien en propre : ce qu’elle apporte, ce qu’elle est, sa personne, tout appartient à celui qu’elle prend pour époux » ; de son côté, le Niu-hien-shu souligne qu’à la maison une femme doit être « comme une ombre et un simple écho » (cit. apud S. Trovatelli, Le civiltà e le legislazioni dell’antico Oriente, Bologne, 1890, p. 157-158).
On donnera ici un aperçu sur quelques conceptions antiques où s’affirme distinctement le type pur de la femme traditionnelle, capable d’une offrande qui se tient à la frontière de ce qui est humain et de ce qui est plus qu’humain. Rappelons d’abord la tradition aztèque-nahua, où seules les mères mortes en accouchant(6) participaient au privilège de l’immortalité céleste propre à l’aristocratie guerrière, car on estimait qu’il s’agissait d’un sacrifice semblable à celui de l’homme qui meurt sur le champ de bataille. On peut indiquer ensuite comme exemple le type de la femme hindoue, féminine jusque dans chaque fibre de son être, jusqu’aux possibilités extrêmes de la sensualité, et néanmoins animée d’une fides invisible et votive, en vertu de laquelle l’offrande, qui déjà se manifestait dans le don érotique du corps, de la personnne et de la volonté, culminait dans un acte très différent et allant bien au-delà des sens : l’épouse jetait sa vie dans les flammes du bûcher funéraire aryen pour suivre dans l’au-delà l’homme auquel elle s’était donnée. Ce sacrifice traditionnel — « barbarie » pure aux yeux des Européens et des européanisés — où le corps de la veuve était brûlé en même temps que celui de son mari mort, est appelé en sanscrit sati, de la racine as et du thème sat, « être », d’où dérive aussi satya, le « vrai » ; et sati signifie également don, fidélité, amour (7). Le sacrifice en question était donc conçu comme l’apogée de la relation entre deux êtres de sexe différent, comme leur relation absolue, reposant dans la vérité et la surhumanité. Ici, l’homme devient appui d’une bhakti libératrice, et l’amour se change en une voie et une porte. L’enseignement traditionnel disait en effet que la femme qui accompagnait son époux dans la mort, atteignait le « ciel » : elle était transformée dans la substance même de son mari (8) ; elle participait à cette transfiguration par le « feu » du corps charnel en un corps de lumière divin, transfiguration dont l’incinération rituelle du cadavre était le symbole (9). Le fréquent renoncement à la vie des femmes germaniques, lorsque le mari ou l’amant mourait à la guerre, s’opérait sous une forme analogue.
(6) Cf. A. Réville, Les religions du Mexique etc., cit., p. 190.
(7) Cf. G. De Lorenzo, Oriente ed Occidente, Bari, 1931, p. 72. On retrouve aussi des coutumes analogues chez d’autres peuples indo-européens : les Thraces, les Grecs, les Scythes et les Slaves (cf. C. Clemen, Religionsgeschichte Europas, Heidelberg, 1926, I, p. 218). Dans la civilisation des Incas, le suicide de la veuve qui suit son mari dans la mort, bien que non établi par une loi, n’en était pas moins courant ; les femmes qui n’avaient pas le courage de l’accomplir ou qui croyaient avoir des motifs de s’en dispenser, devenaient objets de mépris (cf. A. Réville, op. cit., p. 374).
(8) Cf. Mânavadharmaçâstra, IX, 29 : « Celle qui ne trahit pas son mari, et dont les pensées, les paroles et le corps sont purs, parvient après sa mort au même séjour que son époux ».
(9) Cf. Brihadâranyaka-upanishad, VI, ii, 14 ; Proclus, In Tim., V, 331 b ; II, 65 b.
On a déjà indiqué que l’essence de la bhakti en général est l’indifférence pour l’objet ou la matière de l’action, à savoir que cette essence est l’acte pur, la disposition pure. Cela aidera sans doute à faire comprendre que dans une civilisation traditionnelle comme la civilisation hindoue, le sacrifice rituel de la veuve — sati — pouvait être institutionnalisé. En vérité, lorsqu’une femme ne se donne et ne se sacrifie que pour un lien plus fort avec un autre être, que pour une passion partagée, on reste dans le cadre de simples phénomènes sentimentaux privés. Le dévouement ne participe à une valeur transcendante que lorsqu’il peut s’accomplir et se développer sans aucun soutien.
Dans l’Islam, avec l’institution du harem, des contenus du même type eurent l’occasion de s’exprimer. On sait que dans l’Europe chrétienne, pour qu’une femme renonce à la vie extérieure et choisisse le cloître, l’idée de Dieu est nécessaire — et l’on sait aussi que cela a toujours constitué une exception. En revanche, dans l’Islam, pour arriver au même résultat un homme suffisait et la clôture du harem était une chose naturelle qu’aucune femme bien née ne songeaitt à discuter et à laquelle elle n’entendait pas renoncer. Il semblait naturel qu’une femme concentrât toute sa vie sur un homme, lequel était aimé de façon si large et impersonnelle qu’elle admettait que d’autres femmes pussent éprouver le même sentiment et fussent unies à lui par le même lien et le même dévouement. Cela met précisément en relief le caractère de « pureté » essentiel à la voie dont nous parlons. L’amour qui pose des conditions et exige en échange amour et dévouement de la part de l’homme, est un amour d’ordre inférieur. D’ailleurs, un homme purement masculin ne pourrait connaître l’amour entendu en ce sens qu’en se féminisant, donc en s’éloignant précisément de cette autonomie intérieure qui fait que la femme peut trouver en lui un soutien, quelque chose qui exalte son élan dans le don de soi. Dans le mythe, Çiva, conçu comme le grand ascète des sommets, par son seul regard réduit en cendres Kâma, dieu de l’amour, lorsque celui-ci tente d’éveiller en lui une passion pour son épouse Parvatî. La légende relative au Kalki-avatâra contient de même une signification profonde : il y est question d’une femme que nul ne pouvait posséder, parce que les hommes qui la désiraient et en étaient épris, étaient par là même changés en femmes.
Il n’y a de vraie grandeur chez la femme que lorsqu’elle donne sans demander, devenant une flamme qui s’alimente toute seule, que si elle aime lors même que l’objet de son amour ne s’attache pas, ne s’abaisse pas, mais crée une distance : dans la mesure même où il est le Seigneur, au lieu d’être simplement l’époux ou l’amant. Or, il y avait beaucoup de cela dans la mentalité du harem : le dépassement de la jalousie, donc, chez la femme, le dépassement de l’égoïsme passionnel et de l’idée de possession. On lui demandait en effet, de l’adolescence au déclin, le dévouement claustral et la fidélité à un homme qui pouvait être entouré d’autres femmes, qui pouvait les posséder toutes sans se « donner » à aucune. C’est précisément dans cette « inhumanité » qu’il y avait quelque chose d’ascétique et — sans aucun doute — de sacré (10). Dans cette apparente réduction au rang de chose, brûle une vraie possession, un dépassement — et aussi une libération : devant une fides si inconditionnée, l’homme, sous son aspect humain, n’est plus qu’un moyen, et pour la femme des possibilités s’éveillent déjà en rapport avec ce qui n’est plus terrestre. De même que la règle du harem imitait celle des couvents, ainsi la loi islamique pour la femme conduisait celle-ci, selon les potentialités de sa nature — la vie des sens n’étant pas exclue, mais incluse et même exacerbée — sur le plan même de l’ascèse monacale (11). Du reste, il faut envisager la présence, comme prémisse naturelle, d’une attitude analogue chez la femme, à un degré moindre, dans les cultures où le concubinage eut un caractère en quelque sorte régulier et fut légalement reconnu comme un complément du mariage monogamique. On sait que ce fut le cas en Grèce, à Rome et ailleurs. L’exclusivisme sexuel y était pareillement dépassé.
(10) Le Mânavadharmaçâstra ne prescrit pas seulement que la femme ne doit jamais prendre d’initiative et doit, selon sa condition, appartenir à son père, à son mari ou à son fils (V, 147-148 ; IX, 3), mais ajoute (V, 154) : « Quoique la conduite de son époux soit blâmable, bien qu’il se livre à d’autres amours et soit dépourvu de bonnes qualités une femme vertueuse doit constamment le révérer comme un Dieu ».
(11) L'offrande sacrale du corps et même de la virginité fut institutionnalisée sous une forme rigoureuse dans un autre objet de scandale pour les modernes : la prostitution sacrée, pratiquée, durant l’Antiquité, dans des temples syriaques, lyciens, lydiens, à Thèbes en Egypte, etc. La femme ne devait pas faire le premier don de soi pour un mobile passionnel orienté vers un homme bien précis ; elle devait se livrer au premier venu qui, dans l’enceinte sacrée, lui donnait une pièce de monnaie, d’une valeur quelconque : et ce dans l’esprit d’un sacrifice, d’une offrande à la déesse. La femme ne pouvait se marier qu’après avoir ainsi offert rituellement son corps. Hérodote (I, 199) rapporte de manière significative qu’« une fois qu’elle est rentrée chez elle, on peut offrir [à cette jeune fille devenue femme] la plus forte somme : on n’obtiendra plus rien d’elle » — ce qui suffit à montrer combien peu les « moeurs dissolues » et la « prostitution » entraient dans tout cela.
Naturellement, nous ne prenons pas en considération ici ce à quoi put se réduire, matériellement et dans tel ou tel cas, le harem ou toute autre institution analogue. Nous songeons à ce à quoi il correspond dans le cadre de la pure idée traditionnelle, et donc à la possibilité supérieure qu’il contient en principe. Répétons que la tâche de la tradition consiste à creuser des tranchées solides, afin que les courants chaotiques de la vie puissent s'écouler dans la juste direction. Libres sont ceux qui, assument cette direction traditionnelle, n'ont pas le sentiment qu'elle leur est imposée,mais s'y perfectionnent spontanément, s'y reconnaissent, au point d'actualiser ainsi, tel un mouvement partant de l'intérieur, la possibilité la plus élevée, « traditionnelle », de leur nature. Les autres, ceux qui respectent matériellement les institutions, leur obéissant, mais sans les comprendre ni les vivre,sont les êtres « soutenus » : bien que privée de lumière, leur obéissance les porte virtuellement au-delà de la limitation individuelle, les place dans la même direction que les premiers. Mais pour ceux qui ne suivent pas l'axe traditionnel, ni dans l'esprit ni dans la forme, il n'y a que le chaos. Ce sont des êtres perdus, « tombés ».
Tel est le cas des modernes, y compris pour ce qui concerne la femme. En fait, il était inconcevable qu'un monde qui a « dépassé » les castes en rendant à chaque être humain – pour reprendre le jargon jacobin – sa « dignité »et ses « droits », pût conserver la moindre intelligence des justes relations entre les sexes. L'émancipation de la femme devait fatalement suivre celle du serf et compléter la glorification du sans-classe et du sans-tradition, à savoir du paria. Dans une société qui ne sait plus rien de l'Ascète, ni du Guerrier ;dans une société où les mains des derniers aristocrates semblent faites davantage pour des raquettes de tennis ou des shakers de cocktails que pour des épées ou des sceptres ; dans une société où le type de l'homme viril – quand il ne s'identifie pas à la larve blafarde appelée « intellectuel » ou« professeur », au fantoche narcissique dénommé« artiste », ou à cette petite machine affairée et malpropre qu'est le banquier ou le politicien – est représenté par le boxeur ou par l'acteur de cinéma ; dans une telle société, il était normal que la femme se révoltât et revendiquât pour elle aussi une « personnalité » et une liberté au sens moderne, donc anarchiste et individualiste, de ces termes. Alors que l'éthique traditionnelle demandait à l'homme et à la femme d'être toujours plus eux-même, d'exprimer par des traits de plus en plus nets ce qui fait de l'un un homme, de l'autre une femme – nous voyons la civilisation moderne se tourner vers le nivellement, vers l'informe, vers un stade qui, en réalité, n'est pas au-delà, mais en-deçà de l'individuation et de la différence des sexes.
Et l'on a pris une abdication pour une conquête. Après des siècles d' « esclavage », la femme a donc voulu être libre, vivre pour elle-même. Mais le« féminisme » a été incapable de concevoir pour la femme une personnalité, sinon en imitant la personnalité masculine,de sorte qu'il n'est pas excessif de dire que ses « revendications »masquent une défiance fondamentale de la nouvelle femme envers elle-même, son impuissance à être et à valoir en tant que femme,et non en tant qu'homme. En raison de cette incompréhension, la femme moderne à ressenti une infériorité tout à fait imaginaire en estiment n'être qu'une femme et comme une offense en étant traité « seulement comme une femme ». elle a été l'origine d'une vocation erronée : à cause d'elle précisément,la femme a voulu prendre une revanche, mettre en avant sa« dignité », montrer sa « valeur » - en se mesurant à l'homme. Seulement, il ne s'est agit en rien de l'homme vrai, mais de l'homme-construction, de l'homme-fantoche d'une civilisation standardisée, rationalisée, n'impliquant quasiment plus rien de vraiment différencié et qualitatif. Dans une telle civilisation, évidemment, il ne peut plus être question d'un quelconque privilège légitime. Les femmes incapables de reconnaître leur vocation naturelle et de la défendre, ne serait-ce que sur le plan le plus bas (car il n'est pas une femme sexuellement épanouie qui envie l'homme et éprouve le besoin de l'imiter), purent donc prouver aisément qu'elles aussi possédaient virtuellement les facultés et les talents – matériels et intellectuels – qu'on rencontre dans l'autre sexe et qui sont généralement nécessaires et appréciés dans une société du type moderne. Au demeurant,l'homme a laissé faire, se comportant en véritable irresponsable ;il a même aidé, poussé la femme dans les rues, les bureaux, les écoles, les usines, dans tous les carrefours contaminateurs de la société et de la culture moderne, favorisant ainsi le dernier stade du nivellement.
Et là où l'émasculation spirituelle de l'homme moderne matérialisé n'a pas restauré de manière tacite la primauté, typique des antiques communautés gynécocratiques, de la femme-hétaïre arbitre d'homme abrutis par la sensualité et travaillant pour elle, le résultat a été la dégénérescence du type féminin jusque dans ses caractéristiques somatiques,l'atrophie de ses potentialités naturelles, l'étouffement de son intériorité spécifique. D'où le type de la garçonne, la jeune fille creuse, superficielle, incapable de tout élan au-delà d'elle-même, et pour finir inapte même à la sensualité et à la transgression : car pour la femme moderne les promesses de l'amour physique offrent souvent moins d'intérêt que le culte narcissique de son propre corps, que le fait de paraître habillée ou le moins vêtue possible, moins d'attrait que l'entraînement physique, le sport, l'argent et ainsi de suite. Il est vrai quel'Europe ne savait déjà pas grand-chose de la pureté de l'offrande, de la fidélité qui donne tout et ne demande rien, d'un amour suffisamment fort pour n'avoir pas besoin d'être exclusif.
En dehors d'une fidélité seulement conformiste et bourgeoise, l'amour que l'Europe avait choisi, c'était celui n'admettant pas que l'être aimé n'aime pas. Or, quand une femme, pour se consacrer à un homme, prétend que celui-ci lui appartienne corps et âme, elle ne se contente pas d' « humaniser »et d'appauvrir son offrande ; elle commence à trahir un mode d'être propre à la nature masculine – de l'espèce la plus basse : la possession, le droit sur l'autre et l'orgueil du Moi. Le reste a suivi et, comme dans toute chute, avec une accélération croissante. Dans une étape ultérieure, son égocentrisme augmentant, ce ne sont même plus les hommes qui intéressent la femme, mais seulement ce qu'ils peuvent lui donner pour satisfaire son plaisir ou sa vanité. Comme épilogue, on a des formes de corruption accompagnées d'autant de superficialité, ou bien une existence pratique ou extravertie de type masculin qui dénature la femme et la jette dans la fosse masculine du travail, du gain, de l'activité pratique paroxystique et même de la politique.
Les résultats de l' « émancipation » occidentale, d'ailleurs en train de contaminer le monde entier avec plus de rapidité que la peste, ne sont pas différents. La femme traditionnelle, la femme absolue, en se donnant, en ne vivant pas pour soi, mais en voulant être tout entière pour un autre être, avec simplicité et pureté, s'accomplissait, s'appartenait, avait un héroïsme spécifique – et, au fond, s'élevait au-dessus de l'homme commun. La femme moderne, elle, s'est détruite en voulant vivre pour elle-même. La « personnalité » tant désirée lui enlève toute personnalité.
Il est donc facile de prévoir ce que doive devenir, dans cette perspective, les relations entre les sexes, y compris sur le plan matériel. Ici, comme dans le magnétisme, plus forte est la polarité, plus l'homme est vraiment homme et la femme vraiment femme, plus haute et vive est l'étincelle créatrice. En revanche, que peut-il y avoir entre ces êtres mixtes, privés de tout rapport avec les forces de leur nature la plus profonde ? Entre ces êtres où la sexualité commence et finit sur le plan physiologique, à supposer même que des inclinations anormales, celle du « troisième sexe », ne se soient pas déjà manifesté ? Entre ces êtres dont l'âme n'est ni masculine, ni féminine, ou bien qui sont féminins tout en étant des hommes et masculins tout en étant des femmes, et qui exaltent comme un au-delà du sexe ce qui, en fait, est régression en-deçà du sexe ? Toute relation ne pourra plus avoir qu'un caractère équivoque et falot : promiscuité agrémentée d'esprit de camaraderie, morbides sympathies « intellectuelles », banalité du nouveau réalisme communiste – ou bien souffrira de complexes névrotiques et de tout ce sur quoi Freud a édifié une « science » qui est vraiment un authentique signe des temps. Le monde de la femme« émancipée » ne comporte pas d'autres possibilités, et les avant-gardes de ce monde, la Russie et l'Amérique du Nord, sont déjà là pour nous offrir à ce sujet, des témoignages tout particulièrement significatifs.(12)
Or, tout cela ne peut pas ne pas avoir des répercussion sur un ordre de choses qui va beaucoup plus loin que ce que les modernes, dans leur légèreté, peuvent imaginer.
(12)Selon des statistiques remontant déjà à l'année 1950, faites sur une base médicales (C. Freed et W. S. Kroger), 75% des jeunes filles nord-américaines serait « sexuellement anesthésiées », et leur « libido » (pour reprendre le terme freudien) se serait principalement déplacée dans la direction du narcissisme exhibitionniste. Chez les femmes anglo-saxonnes en général, on pouvait observer une inhibition névrotique de la vie sexuelle, authentiquement féminine, ces femmes ayant été victimes d'un faux idéal de « dignité », pour ne pas parer des préjugés dus au moralisme puritain. La réaction appelée « révolution sexuelle » ne conduit qu'à un insipide régime de corruption médiocre, au sens comme produit de consommation courante.
[J. Evola - Révolte contre le monde moderne, L'Age d'Homme 2009, pp. 206-215.]

/image%2F0578236%2F20170916%2Fob_5f4576_logo-dinul-qayyim.png)

/https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-8kY6AdqiRW8%2FWd_R_LpHLLI%2FAAAAAAAAOx0%2FQty-wBolFlQDW8BYWePlnHGb2ziZW7z2gCLcBGAs%2Fw1200-h630-p-k-no-nu%2FMULADAR1.jpg)
/https%3A%2F%2F3.bp.blogspot.com%2F-QjSAy8Wz6gE%2FWgYyG3OzmpI%2FAAAAAAAAO0Y%2F7qadS2NzK6UgRvgPEjZTWeJ0MkdYVj3wQCLcBGAs%2Fw1200-h630-p-k-no-nu%2F2.jpg)
/image%2F0578236%2F20170930%2Fob_7565e4_revolte.jpg)